
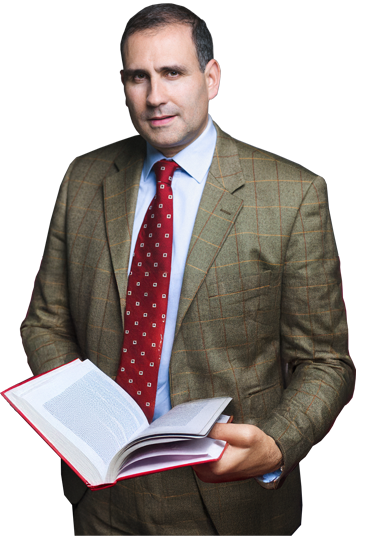
Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
La vente du chiot et du chien
III – Le consentement
La vente d’un animal domestique consiste en un contrat civil bilatéral, par lequel l’acheteur s’engage à prendre livraison de l’animal et à en payer le prix et par lequel le vendeur s’engage à le lui livrer et à le garantir.
Le contrat fait loi entre les parties conformément à l’article 1103 du code civil. Comme la plupart des contrats, la vente n’est soumise à aucune forme particulière et s’opère par le simple échange des consentements sur la chose et sur son prix, à défaut de conditions particulières insérées au contrat (article 1583 du code civil).
A – la validité du consentement
En vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties figure parmi les conditions essentielles à la validité d’une convention, avec la capacité qui vient d’être évoquée en supra.
Or, selon les articles 1130 et suivants du même code, le consentement n’est pas valable s’il a été donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.
Un consentement vicié permet à la partie qui l’a donné d’obtenir la nullité du contrat, lequel sera dès lors réputé n’avoir jamais existé. Si la nullité est prononcée par la Justice ou convenue entre les parties, celles-ci seront replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente. L’action en nullité doit être entreprise dans le délai de 5 ans et est régie par l’article 1144 du code civil.
1°) L’erreur
L’erreur doit porter sur la substance même de la chose, entendue comme ses caractéristiques ou son utilité, et non sur un vice ou un défaut.
L’annulation du contrat de vente d’un animal pour cause d’erreur est en pratique assez rare, dans la mesure où les conflits s’élevant par l’insatisfaction de l’acheteur portent le plus souvent sur des pathologies qui sont des vices ou des défauts rendant l’animal impropre à son usage normal.
Ainsi, l’erreur pourra être opposée au vendeur, seulement si elle porte sur une qualité substantielle de l’animal, absente ou décevante pour un autre motif qu’un vice ou un défaut le rendant impropre à son usage normal.
Il s’agira par exemple de la conviction d’avoir acheté un chien de variété à poil long, alors que le sujet appartient à la variété à poil court. Il n’y aurait pas de vice ou de défaut ici, mais uniquement une qualité intrinsèque qui ne correspond pas à ce que croyait acheter l’acquéreur.
L’erreur est rarement invocable, et ce pour trois raisons :
Lorsque la qualité substantielle sur laquelle porte l’erreur est la conséquence d’un vice caché ou d’un défaut de même nature qui rend l’animal impropre à l’usage auquel il était destiné, la garantie des vices cachés (réduite à la garantie des vices rédhibitoires pour les animaux) est le seul fondement possible de l’action exerçable par l’acheteur,
L’acheteur doit s’être montré suffisamment curieux pour que l’erreur lui soit excusable, même si l’espace laissé à sa curiosité s’est réduit au gré de l’augmentation progressive de l’obligation d’information pesant sur le vendeur par les articles 1112-1 et 1602 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation et L. 214-8 du code rural,
Enfin, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement de l’acheteur.
Par exemple, un acquéreur voulait absolument un chiot à la robe marron truitée et l’avait précisé à l’éleveur qui ignorait que l’étalon primipare ayant couvert sa chienne marron truitée, était porteur homozygote du gène de la robe marron unicolore.
Les chiots nés sont tous marrons unicolores. Le consentement de l’acheteur a été vicié par une erreur sur la substance. Cette dernière n’est pas affectée par un vice ou par un défaut. La couleur de la robe est naturelle et non-dénaturée.
L’animal n’est pas, dans ce cas, affecté d’un vice. Il est juste dépourvu d’une qualité convenue, sans que le vendeur l’ait su.
En pareille situation, l’acheteur pourrait donc fonder son action sur la garantie de conformité pour les ventes opérées avant le 1er janvier 2022, mais aussi sur l’erreur, ce qui lui imposerait dans ce dernier cas de devoir rendre l’animal, puisque l’action fondée sur l’erreur vise l’annulation du contrat de vente.
2°) Le dol
Le dol est l’erreur induite par le comportement du vendeur qui a dissimulé sciemment à l’acquéreur un élément déterminant de son consentement par manœuvre, silence, réticence, ou mensonge.
Pour annuler un contrat, le dol doit avoir été déterminant dans le processus décisionnel de l’acheteur et le vendeur doit avoir agi intentionnellement. Si le second élément fait défaut, l’erreur pourrait être éventuellement retenue.
On évoque par exemple la transmission de fausses informations sur les géniteurs que l’on sait déterminantes du consentement de l’acheteur.
Par exemple, un acquéreur réserve un chiot à la robe marron unicolore à naître d’une saillie entre deux chiens marrons truités. L’éleveur s’abstient d’indiquer à son cocontractant que tous les chiots seront forcément marrons truités. La livraison pourrait être refusée à bon droit par l’acquéreur qui serait fondé à demander l’annulation de la vente pour dol, sans préjudice de dommages et intérêts s’il a manqué une autre portée contemporaine qui aurait pu lui apporter l’animal conforme à sa recherche (article 1240 du code civil).
L’action fondée sur le dol est cumulative avec celle fondée sur la garantie des vices cachés ou encore avec l’action en garantie de conformité.
La disparition depuis le 1er janvier 2022 de la garantie de conformité, qui est une responsabilité sans faute, a accru les actions fondées sur le dol.
Lorsque la manœuvre dolosive est en plus frauduleuse, notamment par l’usage de faux documents ou d’une fausse qualité, le dol devient alors une escroquerie, délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende (Article 313-1 du code pénal).
3°) La violence
Il est évident qu’une vente ou une réservation conclue par l’effet de moyens de pression ou d’intimidation d’une partie sur l’autre, n’a pas sa place dans l’économie d’une société civilisée. Cela peut paraître difficile à concevoir, mais il demeure que des ventes par violence ont cours régulièrement.
Concrètement, l’annulation d’une vente pour violence suppose que l’un des cocontractants ait suscité ou exploité chez l’autre un sentiment de crainte afin de le contraindre à donner son consentement. Cela implique que des menaces aient été proférées ou insinuées.
A l’instar de l’erreur et du dol, la violence s’appréciera en considération de la personne de la victime, notamment de son âge, de sa profession, de son inexpérience, de sa santé et de sa dépendance économique.
Par exemple, l’éleveur qui se montre agressif envers celui qui visite son élevage sans vouloir finalement lui réserver un chiot, ou bien le visiteur d’un élevage qui se montre menaçant parce que les conditions de réservation ne lui conviennent pas.
4°) la tromperie
Elle est un délit pénal prévu à l’article L. 441-1 du code de la consommation, qui la réprime d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende.
Bien que n’appartenant pas aux vices du consentement, qui s’opèrent par définition lors de la formation du contrat, la tromperie, qui doit porter sur une « marchandise », semble voisine du dol du contrat de vente.
Il ne faut cependant pas les confondre.
D’une part, la tromperie ne peut avoir lieu que dans une vente réalisée par un vendeur professionnel au profit d’un consommateur ou d’un non-professionnel, contrairement au dol qui vaut dans toutes les relations contractuelles.
D’autre part, la tromperie peut avoir pour auteur le vendeur, mais également un tiers au contrat, même non professionnel, alors que le dol a nécessairement pour auteur le vendeur.
Par ailleurs, contrairement au dol qui doit avoir induit en erreur l’acheteur au plus tard lors de la conclusion du contrat, puisqu’il est un vice du consentement, la tromperie peut survenir à tous les stades de la relation contractuelle : lors des renseignements donnés par le vendeur, à la conclusion du contrat, à la livraison, voire durant la période de garantie.
Enfin, le dol réside dans la désinformation ou dans le silence du vendeur sur un élément déterminant du consentement de l’acheteur, tel que si ce dernier l’avait su, il n’aurait pas contracté.
La tromperie, quant à elle, ne dépend pas de cette notion subjective. Elle doit être objective et porter sur la nature, l’origine, l’espèce, les qualités substantielles, l’aptitude à l’emploi, les contrôles effectués, ou l’identité de la chose vendue. C’est-à-dire qu’elle doit apparaître à tout acheteur normalement constitué. L’auteur de la tromperie doit être de mauvaise foi.
De plus, la tromperie étant un délit pénal, l’action civile de l’acheteur devrait surmonter la présomption d’innocence du vendeur pour triompher, si elle était portée devant le tribunal correctionnel dont la saisine n’est pas exclusive.
Exemples de tromperies :
La vente d’un chien annoncé comme ayant été vacciné, alors qu’il ne l’était pas.
La vente d’un chien présenté comme étant de race, alors qu’il ne l’est pas.
La vente d’un chien atteint d’une maladie connue du vendeur et qui l’a passée sous silence,
La vente précédée d’une annonce présentant faussement le chiot comme étant inscrit au LOF.
B – La rétractation du consentement
Le droit de rétracter son consentement, ou plus concrètement ici sa volonté de réserver ou d’acheter, est reconnu au consommateur et au non-professionnel, entendu comme le client de l’éleveur par l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Le vendeur ne dispose pas du même droit.
La force obligatoire du contrat tirée de l’article 1103 du code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, souffre de ce tempérament, érigé pour protéger l’acheteur profane de l’ascendance du vendeur professionnel.
Le droit de rétractation est offert par la loi à l’acheteur d’un animal domestique uniquement à l’occasion des contrats conclus à distance ou des contrats conclus hors établissement.
Le droit de rétractation n’est pas dû par le vendeur si l’animal a fait l’objet de modification (par exemple un fouet laissé entier) ou de personnalisation à la demande ou à l’initiative de l’acheteur (pucé plutôt que tatoué, nom choisi, pédigrée export, vaccin optionnel), donc y compris avant la cession effective.
1/ le contrat de vente à distance
Le contrat de vente conclu à distance implique l’emploi par le vendeur d’un système organisé qui n’est pas nécessairement celui de la vente en ligne et une signature hors la présence simultanée des deux parties (vendeur et acquéreur).
La notion de « système organisé » prévue à l’article L. 221-1 du code de la consommation reste subjective. Tout dépendra concrètement du fonctionnement du site internet de l’éleveur et de la sophistication de ses procédures de vente.
La vente qui se concrétise à l’élevage, après consultation d’une annonce en ligne, n’est pas une vente à distance. Car en droit, l’offre de cession n’est pas la cession elle-même.
La livraison à domicile n’est pas non plus en elle-même la preuve que la vente s’est conclue à distance. Il suffit que le contrat ait été signé à l’établissement, mais que le client ait demandé à ce que l’animal lui soit livré à son domicile ou ailleurs, pour que l’acte ne constitue pas une vente à distance.
La vente en ligne (vente sur internet) est un procédé de vente à distance.
Elle est la vente qui s’opère entièrement par le numérique. Elle suppose donc l’existence d’un site marchand.
La loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021, entrée en vigueur le 02 décembre de la même année, a posé le principe d’une interdiction des ventes en ligne d’animaux domestiques, par l’insertion d’un VI à l’article L. 214-8 du code rural.
Tout principe ayant ses exceptions, la loi en avait disposé.
Ainsi l’interdiction des ventes en ligne peut être aisément surmontée par :
La création d’une rubrique spécifique aux ventes d’animaux.
La rubrique doit comporter des messages de sensibilisation et d’information du futur détenteur quant à l’acte d’acquisition d’un animal et à ses implications.
Le respect des mentions obligatoires des articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 du code rural (voir I. A/ et B/ en supra).
Depuis le 1er janvier 2024, la vente en ligne est réservée aux éleveurs lorsqu’il s’agit d’un chien ou d’un chat, puisque les commerçants ont perdu la faculté de vendre ces espèces d’animaux par la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021.
L’expédition des animaux par voie postale est interdite. Le recours à un transporteur animalier est donc obligatoire.
L’achat en ligne d’un animal est d’évidence un contrat à distance générateur d’un droit de rétractation par la réception de l’animal par l’acheteur.
2/ Le contrat hors établissement
Les contrats conclus hors établissement sont ceux qui sont signés en la présence simultanée des parties, mais en un autre lieu que l’établissement du vendeur.
Concrètement, ce sont les ventes qui se traitent par démarchage du vendeur au domicile de l’acheteur ou en tout autre lieu, tel un lieu de travail, et ce même sur la sollicitation de l’acquéreur. Le démarchage peut consister aussi en un racolage, si l’acheteur démarché suit ensuite le vendeur à son établissement pour signer un contrat de vente.
Le contrat de stricte réservation, celui qui n’emporte pas cession, ne confère pas de droit de rétractation. Seul le contrat cession (le contrat de vente) conclu à distance ou hors établissement confère cette faculté à l’acheteur.
Le contrat de réservation peut consister en un échange d’e-mails. Il ne serait pas dans ces conditions un contrat signé hors établissement.
Le contrat de vente qui se signe dans une gare pour convenance de l’acheteur, mais dans le prolongement d’un contrat de réservation (signé à distance ou non) ne procure pas de droit de rétractation, car sa conclusion ne résulte ni d’un procédé de vente à distance, ni d’un démarchage. Les parties étaient déjà en relation contractuelle.
3/ Naissance et extinction du droit de rétractation
Le droit de rétractation dont bénéficie l’acheteur naît par la réception de l’animal par l’acheteur et meurt au plus tard dans les 14 jours suivants la réception de l’animal.
Pour les contrats conclus hors établissement, l’acheteur peut exercer son droit à compter de la signature du contrat. Il bénéficiera quand même du délai de 14 jours une fois le chien livré.
Cette durée est prorogée de 12 mois, si le vendeur a manqué à son obligation complète d’information de l’acheteur quant à l’existence et aux modalités d’exercice du droit de rétractation.
Les textes utiles pour maîtriser le droit de rétraction sont les articles L. 221-1, L. 221-18 à L. 221-23 du code de la consommation.
Le délai de rétractation court à compter du lendemain de la réception de l’animal qu’elle soit à son domicile ou à l’établissement du vendeur.
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
4/ Exercice du droit de rétractation
Le droit de rétractation est un droit discrétionnaire, faisant que son exercice par son titulaire n’a pas à être motivé.
L’exercice du droit de rétractation doit s’exprimer sans équivoque. Il se formalise par un écrit sur papier libre ou au moyen du modèle figurant à l’article R. 221-1 du code de la consommation.
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.