
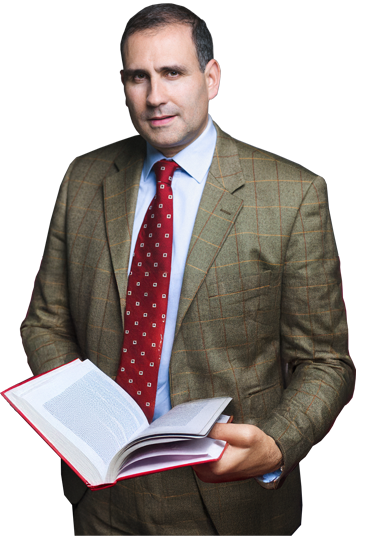
Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Création de l'élevage
Chapitre I – les conditions pour devenir éleveur en France
II - Le choix d’une structure juridique d’exploitation
L’éleveur et son conjoint, en fonction de l’état de leurs patrimoines, de la prévision de leurs futures implications dans l’exploitation, de leurs apports matériels à l’entreprise, des risques financiers et surtout de leur situation matrimoniale sont fortement incités à prendre conseil auprès d’un notaire, d’un avocat ou d’un expert-comptable, bien au fait des entreprises agricoles, avant de choisir la forme de la structure d’exploitation.
La structure juridique pour exploiter un élevage peut être soit directe, soit par une société (personne morale). Dans les deux cas, l’exercice peut être individuel ou conjoint.
A - Les structures d’exploitation directe
L’éleveur, entendu comme celui qui œuvre, est une personne physique. Il en est de même de son éventuel conjoint co-exploitant ou collaborateur. On dit donc qu’un élevage est en exploitation directe lorsque l’exploitant (l’éleveur et son éventuel conjoint) est ou sont le(s) propriétaire(s) de l’entreprise agricole qu’il(s) exploite(nt). Il(s) cumule(nt) donc les actions d’œuvrer pour l’exploitation et de posséder celle-ci.
Ainsi, les biens de l’exploitation tels que le matériel, les engins, les véhicules, les animaux, et les créances qui peuvent résulter de contrats, appartiennent directement à l’éleveur, personne physique ou à la communauté qu’il forme avec son conjoint, sans le truchement d’une société. Les biens affectés à l’élevage restent dans le patrimoine propre de l’éleveur et éventuellement de celui de son conjoint en cas de communauté.
Il existe deux structures d’exploitation directe :
1°) l’entreprise individuelle (EI)
Elle confère à l’entrepreneur, entendu ici comme l’éleveur, le statut d’agriculteur. Elle est le mode d’exercice le plus répandu chez les éleveurs canins et félins. L’exploitant se voit attribuer par l’INSEE qui gère le répertoire SIRENE, un numéro SIREN à 9 chiffres pour son entreprise et un numéro SIRET à 14 chiffres pour son établissement. Le SIRET n’est autre que le numéro SIREN suivi du numéro d’établissement qui comprend cinq chiffres numérotant l’établissement tel que 00023 par exemple. Cela ne signifie pas que l’entreprise a 23 établissements. Un établissement unique peut recevoir ce numéro.
S’agissant de la représentation de l’entreprise envers les tiers, lorsque deux époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation, l’article L. 321-1 du code rural dispose qu’ils sont présumés s’être donnés réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration courants de l’exploitation.
Le conjoint co-exploitant est copropriétaire de l’exploitation dont le fonds agricole est soit un bien commun, soit un bien indivis selon le régime matrimonial.
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est quand même présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration courants. Cette situation se rencontre dans les unions sous un régime matrimonial séparatiste ou lorsque l’un des conjoints était déjà propriétaire de l’exploitation avant son mariage sous un régime communautaire.
Depuis l’institution de l’EIRL, l’EI tombe progressivement en désuétude.
2°) l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
Elle est consacrée par l’article R. 311-1 du code rural et se distingue de l’entreprise individuelle uniquement par le caractère parcellaire du patrimoine affecté à l’exploitation par l’éleveur. La démarche consiste en une déclaration d’affectation organisée par les articles L. 526-6 et suivants du code de commerce, dont la finalité est à l’évidence d’exclure du gage des créanciers de l’exploitation les biens qui n’y ont pas été affectés.
Ces biens exclus ne pourraient donc se voir emportés par une éventuelle liquidation judiciaire ou être saisis par les créanciers de l’exploitation, c’est-à-dire ceux dont la créance est née de leurs rapports avec l’élevage, tels que l’acquéreur d’un chiot, un salarié, la MSA, ou encore un fournisseur. En cas de fraude de l’exploitant, le gage de la MSA est étendu au patrimoine complet du débiteur.
Les règles applicables au conjoint de l’agriculteur sont identiques à celles de l’entreprise individuelle. L’EIRL confère bien entendu à l’éleveur le statut d’agriculteur et bien que l’entrepreneur soit tenu de faire figurer le sigle EIRL avant ou après la dénomination de son entreprise. La création d’une EIRL n’engendre pas la constitution d’une société, sans quoi elle serait une structure d’exploitation indirecte.
B - Les structures d’exploitation indirecte
Elles sont en plus grand nombre. Elles tirent leur attrait de la volonté des associés (ou d’un associé unique) de regrouper au sein d’une même structure l’ensemble de leurs (ses) activités agricoles, d’éviter les situations d’indivision, voire de servir d’outil de transmission progressive de l’entreprise. Les associés peuvent être un couple et/ou des tiers, membres ou non d’une même famille.
Seules les formes juridiques adaptées aux élevages canins et félins, de par les moyens mobilisés et les objectifs poursuivis, seront abordées ici.
1°) La société civile d’exploitation agricole (SCEA)
Elle est la société des articles 1832 et 1845 et suivants du code civil à laquelle un objet agricole est donné. Elle nécessite au moins deux associés. Elle peut évidemment être constituée par un couple marié, pacsé ou en concubinage. Son emploi a précédé les autres formes de sociétés agricoles. Elle est choisie par sa souplesse d’utilisation, en ce que les contraintes de rédaction des statuts sont délimitées seulement par le code civil.
Ainsi son objet social civil peut aller au-delà de la seule activité agricole. Ses règles statutaires peuvent être très souples et permettre par exemple l’admission comme associé de personnes morales et/ou de mineurs. Son gérant n’est pas obligatoirement un associé.
Surtout, la SCEA ne suppose pas obligatoirement la présence permanente des associés sur les lieux de l’exploitation, ni leur participation à celle-ci, à la différence de l’EARL.
Ceci dit, l’inconvénient principal de la SCEA est que les associés répondent indéfiniment, mais sans solidarité avec la société, des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital. L’absence de solidarité fait qu’un créancier de la société ne peut poursuivre un associé en paiement des dettes sociales qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (Articles 1857 et 1858 du code civil).
Le montant du capital social est libre. Les apports constituant ce dernier peuvent être effectués en numéraire (argent), en nature (cheptel, bâtiment, matériel…) et en industrie (travail, connaissances, compétences).
2°) L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
Créée par la loi du 11 juillet 1985, codifiée aux articles L et R. 324-1 et suivants du code rural, l’EARL est la forme de société la plus répandue en agriculture tant les ajustements qu’elle procure sont plébiscités par les entrepreneurs qui peuvent créer une structure sur mesure tant au plan juridique que fiscal.
Son but premier est de fournir à l’entrepreneur, même seul, une structure sociétaire pour son exploitation. Elle peut être constituée entre conjoints mariés, pacsés ou en concubinage, co-exploitants ou non, avec un mineur, tout en conservant la soumission du bénéfice agricole à l’impôt sur les revenus. Le nombre d’associés est limité à 10.
Mais, les principaux avantages pour un éleveur de l’EARL sont :
L’EARL est la seule forme de société agricole qui peut être instituée par une seule personne. Elle lui permet d’affecter son patrimoine professionnel à une véritable société, personne morale au patrimoine distinct, et d’isoler ainsi le ou les patrimoines du ou des associés.
Elle est particulièrement recommandée aux couples d’éleveurs, dont les patrimoines lors de la création et surtout les apports ne sont pas égaux entre eux.
La responsabilité financière des associés est limitée à leurs apports à l’EARL. En d’autres termes, les associés ne sauraient être redevables des dettes sociales sur leurs deniers personnels non-apportés à la société.
L’EARL permet d’admettre des associés non-exploitants, donc des apporteurs de capitaux, y compris le conjoint. Si la société comprend dans sa composition un apporteur de capitaux, non-conjoint, elle est imposable à l’impôt sur les sociétés.
Les exploitants associés bénéficient d’un traitement particulier leur assurant la majorité dans le capital social et la gérance, autrement-dit le contrôle et l’administration de l’entreprise.
Les statuts de l’EARL permettent de fixer les rémunérations des associés-exploitants du fait de leur travail à l’exploitation. La rétribution du travail est une charge de personnel pour la société qui vient en déduction du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires minoré des charges est le bénéfice agricole. Le droit au bénéfice est quant à lui reconnu à tous les associés à proportion de leurs apports au capital.
Les contraintes :
L’EARL comprend obligatoirement un ou plusieurs associés-exploitants. Ne peuvent être considérés comme tels que les associés majeurs qui participent effectivement à l’exploitation au sens de l’article L. 411-59 du code rural.
Le collège d’associés-exploitants doit être majoritaire dans la composition du capital social, ce qui est à l’évidence le cas de l’associé-exploitant unique.
La gérance de la société doit être occupée par un ou plusieurs associés-exploitants, titulaires de parts représentatives du capital. L’associé-exploitant unique est donc de droit le gérant.
Le capital social doit être au minimum de 7500 euros constitué d’apports en numéraire et/ou en nature. L’apport en industrie n’est pas admis en EARL.
3°) Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC)
Le GAEC est une société civile agricole dont l’intérêt principal est de permettre à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations familiales. Les associés sont obligatoirement des personnes physiques majeures. Le GAEC doit revêtir les caractéristiques d’une exploitation familiale. Le GAEC est particulièrement indiqué en cas de rapprochement des élevages de deux personnes d’une même fratrie, de partenaires pacsés, de personnes mariées ou vivant maritalement. Chacun apporte son élevage, comme apport en nature.
Le GAEC peut être total ou partiel. Le GAEC peut résulter de la jonction d’exploitations agricoles, sans les faire fusionner, tels que deux élevages apportés. L’objet du GAEC peut se limiter à la vente du fruit du travail. Il est dit alors « partiel ».
Les associés du GAEC obtiennent tous le statut d’agriculteur, donc celui de chef d’exploitation. Tous les associés doivent participer de façon égale aux travaux et à la gestion du groupement. Ils perçoivent en contrepartie une rémunération au moins équivalente au SMIC.
4°) Les formes de sociétés appropriées aux autres activités impliquant la détention d’animaux
On fait une place à part aux activités marchandes ou de services sans production, telles qu’une animalerie, une pension et/ou un dresseur. Dans la mesure où il n’y a pas de production animale, les exploitants de ces activités sont soit commerçants pour l’animalerie, soit prestataires de services pour la pension, voire artisan pour le dressage.
Dans ces conditions, ces entrepreneurs devront opter pour une société de forme commerciale telles que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL), la société à responsabilité limité (SARL), la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ou la société par actions simplifiée (SAS) et la société en nom collectif (SNC).
Il n’est pas interdit par la loi à un éleveur d’opter pour une société de forme commerciale, bien que ne correspondant pas à la nature civile de l’activité de production agricole. Les règles de fonctionnement des sociétés commerciales, notamment quant aux cessions de parts sociales ou d’actions, à l’établissement et à la publication des comptes, sont plus complexes que dans l’EARL.
Dans la SARL familiale, restée soumise à l’impôt sur les revenus, pouvoir allier au sein de la même société des activités relevant du bénéfice agricole (l’élevage) et d’autres relevant des bénéfices industriels et commerciaux (vente de matériels, dressage, pension). Ce motif de recours est à relativiser pour les motifs exposés en infra (C, 1°)).
Rien ne justifie aujourd’hui de recourir à la société anonyme pour l’exploitation d’un élevage canin ou félin, d’une pension de chiens ou de chats ou d’un centre de dressage de chiens.