
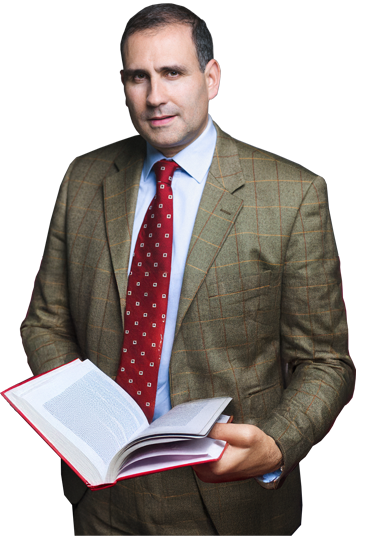
Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Création de l'élevage
Chapitre II – le choix des locaux et les règles d’implantation
III – Les effets du respect des normes environnementales à l’égard des tiers
Une fois acquise la certitude qu’il n’existe pas de dispositions préfectorales ou municipales empêchant ou restreignant la création d’un élevage ou d’un chenil quelconque, il appartient à l’entrepreneur de choisir un terrain dont la localisation répondra aux normes environnementales en vigueur, lesquelles sont fonction de l’effectif des animaux sevrés appelés à y être détenus.
Le droit de l’environnement considère, de façon autonome, qu’un chien est sevré à partir de l’âge de 4 mois révolus, ce qui sous-entend que les chiots de moins de 4 mois ne comptent pas dans l’effectif légal.
Ainsi, le détenteur de 16 chiens composés de 5 adultes, 2 chiots de 5 mois, et de 9 chiots de 2 mois, sera aux yeux de la loi, et donc de la DDPP, détenteur de 7 chiens sevrés.
Pour information, le droit rural reste quant à lui en phase avec les réalités biologiques et considère qu’un chiot est sevré à l’âge de 6 semaines (arrêté du 3 avril 2014, annexe II, section 2, chapitre 2).
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de générer des pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les normes environnementales concernant les chenils sont issues de trois arrêtés du Ministère de l’Ecologie et du développement durable deux en date du 08 décembre 2006 et pour le troisième en celle du 22 octobre 2018. Leur nomenclature a été modifiée par le Décret n° 2021-1558 du 02/12/2021.
Ces normes environnementales s’appliquent à tous les chenils de plus de neuf chiens.
Pour ce qui intéresse le présent guide, seuls les lieux de détention de chiens, donc les chenils, peuvent constituer des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en vertu de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, en sa nomenclature annexée, sous la rubrique n°2120 de la colonne A.
Les chatteries, quel que soient leurs effectifs, ne sont pas concernées par les ICPE.
La préservation de la qualité des eaux et des sols par le raccordement du chenil à un système d’assainissement autonome ou par son raccordement au réseau collectif, ainsi que la protection du voisinage contre les nuisances sonores, sont les principales obligations environnementales à respecter en matière d’élevage ou de pension canine.
Ces obligations s’appliquent autant aux chenils à créer qu’à ceux existants et qu’il faudrait donc mettre en conformité.
Ainsi, les activités relevant des installations classées sont énumérées dans une nomenclature édictée sous l’article R. 511-9 du code de l’environnement et qui les soumet à un régime soit de la déclaration, soit de l’enregistrement, soit de l’autorisation en fonction du niveau des risques ou des inconvénients qu’elles peuvent engendrer. Ce niveau est déterminé par l’effectif de chiens détenus : 10 à 50 chiens, 51 à 250 chiens, plus de 250 chiens.
La mise en œuvre de la législation en la matière est confiée à l’administration qui se voit donc conférer les pouvoirs de :
De délivrer ou de refuser l’autorisation d’exploiter une installation,
De contrôle et de sanction.
Ces opérations sont attribuées aux agents assermentés de l’inspection des installations classées sous l’autorité du Préfet. Ce sont les agents des DDPP et DDETSPP qui sont inspecteurs des installations classées.
En savoir plus sur l’enjeu de l’assainissement et sur la hiérarchie de sa législation :
L’eau est la ressource naturelle la plus sensible en ce qu’elle est indispensable à la vie, donc à l’humain, à la faune et à la flore. Pour ce faire, elle doit être saine et non-polluée.
Les dispositions en matière de gestion durable des ressources naturelles et la notion d’éco-responsabilité pour les générations futures s’imposent à toute personne et à toute entreprise. Le chenil, quel que soit son effectif, sa superficie, et le statut de son tenancier (professionnel ou particulier), est particulièrement concerné.
Les objectifs poursuivis en matière de gestion de l’eau ont conduit la France a transposé en droit français la directive européenne sur l’eau d’octobre 2000 par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
Cette loi vise en particulier l’objectif d’avoir sur le territoire un bon état de l’eau à l’échéance de 2015 et s’impose à toutes les entreprises. Cet objectif n’est pas encore atteint.
La loi se traduit par l’interdiction de déverser les eaux usées dans le milieu naturel sans traitement préalable. Selon les zones définies par les communes, il est obligatoire de se raccorder au réseau communal ou de s’équiper d’un système d’assainissement autonome (non-collectif) et d’en assurer le bon fonctionnement.
Ces obligations figurent au Titre I du livre II du code de l’environnement sur les eaux et les milieux aquatiques, ainsi qu’à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
Ces normes légales sont supérieures à tout arrêté qui est une norme réglementaire, si bien que quand bien même le Ministre de l’Ecologie, le Ministre de l’Agriculture, les Préfets de département et les Maires n’avaient pas pris de dispositions spécifiques en matière d’assainissement à l’égard des possesseurs ou exploitants d’un chenil, aussi restreint soit-il, la partie législative du code de l’environnement fait office de voiture-balai.
En d’autres termes, il n’est pas possible de déroger à la contrainte de l’assainissement.
En résumé, il existe trois causes possibles et cumulables, dont la première est universelle, de se voir obligé de raccorder son chenil ou sa chatterie à un système ou à un réseau d’assainissement :
A – Chenil détenant jusqu’à 9 chiens sevrés et chatteries tous effectifs (hors champ)
Peu important l’activité (élevage professionnel de droit commun non-lof ou d’au moins 2 portées par an au LOF, élevage professionnel dérogatoire de 1 portée par an au LOF, pension ou dressage…), le chenil renfermant moins de 10 chiens sevrés n’est pas une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Il en est de même des chatteries quel que soit leurs effectifs.
Ces chenils et toutes les chatteries ne sont donc pas soumis à déclaration auprès de la DDPP au titre des ICPE.
Ces chenils sont soumis au Règlement Sanitaire Départemental (le RSD) et sont sous l’autorité du Maire de la commune dans le ressort de laquelle ils se situent en ce qui concerne la prévention des pollutions (assainissement), la prévention des nuisances sonores, et pour le respect des règles d’urbanisme (construction et aménagement).
La conception et le fonctionnement de l’élevage ou de la pension ne doivent pas être source de nuisances sonores ou olfactives excessives et présentant un caractère permanent pour le voisinage. La distance d’édification d’un chenil non-ICPE est de 50 mètres au moins des habitations tierces, ainsi que le prévoient les RSD (Règlements sanitaires départementaux).
Le pluriel est employé au sujet du RSD, bien qu’il en existe qu’un seul par département et qu’il consiste en un arrêté préfectoral, au motif que ce règlement est pris sur la base d’un modèle type, de sorte que les RSD sont à 99% identiques d’un département à l’autre. Ils contiennent tous comme dernier titre, le titre VIII intitulé Prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles qui nous intéressent ici.
Le RSD est facilement trouvable et téléchargeable sur internet.
S’agissant de salubrité, de santé publique et de protection de la ressource en eau, le RSD prévoit en son article 153.5 que l’autorité sanitaire (souvent la commune) peut exiger des aménagements spécifiques supplémentaires, après avis du Conseil Départemental d’Hygiène.
Quant à la question de l’assainissement des chenils, le RSD est clair en son article 154.3 :
« les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage (NDLA : telle une fosse toutes eaux ou FTE), ainsi que ces ouvrages sont étanches ».
Le chenil de 9 chiens au plus doit donc être doté ou raccordé à un système d’assainissement autonome (les adjectifs autonome, individuel et non-collectif seront synonymes ici) ou à un réseau d’assainissement collectif, pour des raisons d’écologie et de salubrité.
Cependant, cette dotation ou ce raccordement ne sont pas imposés au nom du bien-être animal, eu égard au faible effectif du chenil, et ce en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2014, tel qu’expliqué plus en détail en infra.
Le raccordement du chenil au système d’assainissement autonome de la propriété est subordonné à ce que la fosse toutes eaux (FTE), la microstation d’épuration ou encore la filière compacte de l’habitation ait une capacité suffisante pour stocker les eaux sales du chenil et celles de l’habitation. Si la capacité de la fosse est insuffisante, des travaux d’agrandissement sont alors nécessaires.
On insiste sur le fait que rigoureusement même le petit chenil du particulier, constitué d’un seul box de 5 m² abritant un chien unique doit déverser ses eaux sales (urines et eaux de lavage) dans un système d’assainissement non-collectif ou vers un réseau d’assainissement collectif, en cas de dévers de la dalle vers le sol à l’état naturel.
En clair, ce raccordement du box à un réseau ou à un système d’assainissement est obligatoire en cas de lavage à grandes eaux, plutôt qu’à la serpillère essorée dans un seau à déverser dans le réseau d’évacuation des eaux sales de la maison.
Une eau chargée en détergent déversée sur un sol naturel va infiltrer le sous-sol et donc polluer les sources et les nappes phréatiques en contrebas, lesquels pollueront à leur tour les cours d’eau dans lesquelles elles débouchent, ce qui va nuire à la faune.
Bien que le RSD n’interdise pas l’évacuation des déjections canines dans le système d’assainissement autonome, autrement-dit non-collectif, il demeure déconseillé de le faire pour la pérennité du bon fonctionnement du dispositif.
L’agglomération des poils de chiens avec leurs déjections ralentit considérablement la décomposition, ce qui entraîne rapidement saturation de la fosse et endommagement fréquent du réseau des drains d’épandage.
Si la propriété est raccordée à un réseau collectif, l’évacuation des déjections n’est pas seulement déconseillée, elle est interdite, sauf autorisation municipale, jamais accordée en pratique.
En effet, le maire renvoie l’interrogation pour avis au Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) qui est chargé de vérifier l’installation au niveau privatif. Le SPANC, pour la raison de l’agglomération des déjections solides avec les poils, émet toujours un avis défavorable.
Les déjections ne doivent pas non plus rejoindre les ordures ménagères.
En pratique, la seule bonne solution à retenir pour le traitement des matières solides est le compostage accéléré par un activateur spécifique aux déjections canines tel que le cynelit ou la fosse à lisier à faire vider par un cultivateur voisin qui en fera ensuite du fumier.
L’article 154.3 ne visant pas les stabulations libres de félins, les chatteries ne sont pas obligées d’être dotées ou raccordées à un système ou à un réseau d’assainissement.
Cependant, il est strictement interdit d’évacuer les déjections félines par le réseau collectif.
Les litières souillées d’urines et de déjections sont souvent évacuées via les ordures ménagères pour les petites chatteries, bien que cela ne soit pas théoriquement licite. Le procédé est donc qualifiable de tolérance en l’absence de gêne occasionnée au voisinage.
Pour les chatteries plus grandes, le recours à un système de compostage sera inévitable tant au niveau pratique pour l’éleveur qu’au niveau de la conformité.
En résumé quant aux sources textuelles, les normes environnementales applicables aux chenils de 9 chiens au plus et aux chatteries sont définies au niveau départemental par le règlement sanitaire pris par application du code de la santé publique et par d’éventuels arrêtés municipaux plus exigeants selon les communes.
B – Chenil détenant de 10 à 50 chiens sevrés inclus (déclaration)
Le chenil de 10 à 50 chiens inclus est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à ce titre à une simple déclaration auprès de la DDPP ou du Préfet, en ce qu’elle ne présente pas de graves dangers ou de nuisances pour l’environnement.
Le particulier qui détient plus de 9 chiens sevrés, même sans élever, doit effectuer pour son chenil une déclaration au titre des ICPE.
A fortiori, l’éleveur d’une seule portée annuelle inscrite au LOF, qui détient plus de neuf chiens sevrés, est tenu d’effectuer la même déclaration et évidemment de mettre en place et d’utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale, mais sans avoir à faire de déclaration à la DDPP au titre de l’activité d’éleveur.
Les textes qui sont spécifiques aux chenils de 10 à 50 chiens sont :
L. 517-2) et sa partie réglementaire, Livre V titre 1 (Articles D. 510-1 à R. 517-10),
Mais, lui sont aussi applicables, bien que ne lui étant pas spécifiques :
1°) Les contraintes environnementales d’implantation sont les suivantes :
* les adjectifs individuel, autonome et non-collectif sont synonymes dans le présent guide.
Cela résulte de l’article 5.4.2 Système d’assainissement individuel de l’arrêté du 8 décembre 2006 sur les installations classées « chenil » n°2120 soumises à déclaration :
« Les capacités techniques du système d’assainissement sont, qualitativement et quantitativement, compatibles avec l’ensemble des effluents reçus. Les données techniques concernant le système d’assainissement sont tenues à disposition de l’inspection des installations classées. »
2°) La procédure de déclaration est la suivante :
Le futur exploitant du chenil à créer ou à modifier doit constituer un dossier de déclaration qui sera transmis en ligne à la Préfecture, service DDETSPP ou DDPP. Le préfet ou la DDPP donne quitus au déclarant de sa déclaration au moyen d’un document officiel intitulé « récépissé de dépôt de la déclaration d’une installation classée CHENIL ».
Ce récépissé est indispensable pour obtenir un permis de construire les bâtiments d’élevage ou le chenil.
Depuis le 1er janvier 2021, la procédure est obligatoirement dématérialisée par une déclaration en ligne.
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, le formulaire de déclaration était le CERFA n°15271*02.
Le formulaire en ligne comporte davantage de rubriques à renseigner et doit être accompagné de documents et de justificatifs tels que plans, dispositions contre les incendies, procès-verbal de conformité de l’assainissement par un BEE (Bureau d’Etudes en Environnement), un plan cadastral, un extrait du PLU et un plan d’ensemble pour l’essentiel.
Il faut savoir que le SPANC (Service Public d’Assainissement Non-Collectif) n’est pas compétent pour se prononcer sur la conformité d’un système assainissement animalier. Il lui arrive cependant de donner son avis à la demande d’une Mairie voulant être rassurée que le système d’assainissement non-collectif installé pour le chenil n’interfère pas avec celui de l’habitation voire avec le réseau collectif municipal.
En droit administratif, le droit de mise en service, soumis à déclaration, s’exerce sans attendre la délivrance d’une autorisation, en ce qu’il est basé sur la bonne foi et l’honnêteté du déclarant. L’absence d’opposition du Préfet vaut admission de la déclaration.
L’exercice de ce droit reste néanmoins exposé au contrôle provoqué ou aléatoire de la DDPP puisque la preuve ou le récépissé de dépôt ne vaut pas agrément de conformité.
La responsabilité du déclarant peut être recherchée en cas de fausse déclaration avec sommation de mettre en conformité l’installation, voire de suspension ou de rejet de la déclaration entraînant un arrêté de fermeture.
C – Chenil détenant de 51 à 250 chiens sevrés inclus (enregistrement)
Le décret du 22 octobre 2018 de n°2018-900 institue une nouvelle catégorie d’ICPE pour les chenils de 51 à 250 chiens dès le 25 octobre 2018 pour les créations et à compter du 1er janvier 2019 pour les chenils existants.
Le chenil de 51 à 250 chiens inclus est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) considérée comme présentant un risque maîtrisé. Cette ICPE est soumise à une procédure d’enregistrement, qui est un régime d’autorisation simplifiée, auprès de la DDPP ou du Préfet.
Les textes qui lui sont spécifiques sont :
L. 517-2) et sa partie réglementaire, Livre V titre 1 (Articles D. 510-1 à R. 517-10),
Mais, lui sont aussi applicables, bien que ne lui étant pas spécifiques :
1°) Les contraintes environnementales d’implantation sont les suivantes :
Soit un système d’assainissement individuel* obligatoirement (évacuation, stockage, traitement). * Les adjectifs individuel, autonome et non-collectif sont synonymes.
Soit par un site spécialisé extérieur tel un centre de compostage ou un centre d’enfouissement à condition qu’il soit autorisé ou déclaré dans les formes prescrites par le code de l’environnement,
Soit par une station d’épuration propre à l’installation, conforme à l’article 28 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif à d’autres installations classées,
Soit par épandage sur des terres agricoles, dans le respect des prescriptions des articles 26 et 27 de l’arrêté du 27 décembre 2013. L’épandage est interdit sur les cultures maraichères.
Soit par tout autre moyen équivalent à ceux énumérés ci-dessus, à condition qu’il soit autorisé par le Préfet.
2°) La procédure d’enregistrement est la suivante (Article R. 512-46-3) :
Le futur exploitant du chenil à créer ou à modifier doit constituer un dossier de demande d’enregistrement qui sera remis en trois exemplaires soit à la Préfecture, soit à la DDPP ou encore à la DDETSPP selon les départements. Il s’agit d’une procédure d’autorisation simplifiée. La formalité peut s’effectuer aussi en ligne. Dans les deux cas, il est fortement conseillé de se rapprocher préalablement du service, au moins par téléphone, avant de déposer son dossier.
Il lui faut employer le formulaire administratif intitulé « Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement », dont le numéro CERFA est 15679*02. Elle comprend l’identité du demandeur, la localisation de l’installation, la description, la nature, le volume des activités et la rubrique 2120 dont relève le chenil.
Les pièces à annexer sont énumérées à l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, mais aussi au formulaire et varient selon les projets.
Cependant, le tronc commun comprend : trois plans, une carte, une description des capacités financières et techniques de l’exploitant, un document justifiant de la compatibilité de l’installation future avec les règles d’urbanisme et surtout un document justifiant que l’installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions générales édictées par l’arrêté du 22 octobre 2018.
Ce dernier document résulte en principe d’une étude d’impacts et constitue la pièce principale du dossier.
C’est en raison de cette pièce qu’il est en pratique indispensable de recourir aux services d’un bureau d’études en environnement (BEE) pour un projet de chenil de plus de 50 chiens.
Le délai d’instruction du dossier est de 5 mois (ou de 7 mois en cas de demande d’aménagement des prescriptions générales) pour que l’administration rende sa décision d’enregistrement ou de refus.
Un avis de consultation du public doit être :
affiché en mairie et sur le site même de l'installation, pendant au moins 4 semaines ;
publié dans 2 journaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de la préfecture.
Après consultation du public, le préfet peut autoriser ou refuser l’enregistrement par arrêté préfectoral. L’exploitant n’est pas autorisé à commencer l’exploitation de son élevage ou de sa pension, prévus de constituer l’ICPE, avant d’avoir obtenu la décision de la Préfecture.
S’il apparait à la Préfecture que la demande relève de la procédure d’autorisation, tel que dans le cas où le projet se situerait dans une zone Natura 2000, le Préfet peut d’office orienter le dossier vers la procédure d’autorisation (Article L. 512-7-2 du code de l’environnement). Il exigera dans ce cas une enquête publique entre autres.
D – Chenil détenant plus de 250 chiens sevrés (autorisation)
Le chenil de plus de 250 chiens est la plus lourde des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en ce qu’elle est censée présenter de graves risques ou nuisances pour l’environnement.
Elle est soumise à ce titre à une autorisation du Préfet du département après une étude d’impact environnemental, une étude de danger, une enquête publique dans un rayon d’un kilomètre et l’acceptation du projet par la municipalité.
Les textes qui lui sont spécifiques sont :
L. 517-2) et sa partie réglementaire, Livre V titre 1 (Articles D. 510-1 à R. 517-10),
Mais, lui sont aussi applicables, bien que ne lui étant pas spécifiques :
1°) Les contraintes environnementales d’implantation sont les suivantes :
Soit un système d’assainissement individuel* obligatoirement (évacuation, stockage, traitement). * Les adjectifs individuel, autonome et non-collectif sont synonymes.
Soit par un site spécialisé extérieur tel un centre de compostage ou un centre d’enfouissement à condition qu’il soit autorisé ou déclaré dans les formes prescrites par le code de l’environnement,
Soit par une station d’épuration propre à l’installation, conforme à l’article 28 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif à d’autres installations classées,
Soit par épandage sur des terres agricoles, dans le respect des prescriptions des articles 26 et 27 de l’arrêté du 27 décembre 2013. L’épandage est interdit sur les cultures maraichères.
Soit par tout autre moyen équivalent à ceux énumérés ci-dessus, à condition qu’il soit autorisé par le Préfet.
2°) La procédure de demande d’autorisation est la suivante (Articles L. 512-1 et suivants du code de l’environnement) :
Le formulaire à utiliser est le CERFA 15294*01.
Elle est très lourde et son instruction peut durer une année, de par l’accumulation de délais impartis aux diverses administrations qui se succèdent pour se prononcer sur le projet.
Le recours à l’assistance d’un bureau d’études en environnement s’avère inéluctable.
Dès que le dossier est déclaré recevable par le Préfet, celui-ci en informe le maire de la commune d’implantation. Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l’enquête publique (Art L. 512-2).
Après les enquêtes et les études évoquées en supra, le dossier est examiné par le CODERST (Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Techniques), après avis de l’autorité environnementale (DDPP – DREAL).
Si le CODERST et le Préfet émettent des avis favorables, un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter est délivré. Compte tenu qu’il contient toujours des prescriptions de mesures préalables visant à écarter les risques d’atteinte à l’environnement, cet arrêté ne procure donc pas encore le droit de mettre en service l’installation.
L'autorisation n'est définitivement délivrée qu'après la mise en place des mesures spécifiées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation pour prévenir les risques redoutés.
Ainsi l’ICPE ne peut être mise en service avant l’octroi de l’autorisation préfectorale définitive prise également sous la forme d’un arrêté.
Diverses publicités locales relatives à l’arrêté préfectoral d’autorisation en Mairie, sur le site internet de l’administration et dans des journaux habilités à recevoir les annonces légales, servent à informer le public de la commune et des communes avoisinantes de l’existence du projet d’installation.
Ces publicités déclenchent les délais d’exercice des recours des tiers contre le projet.