
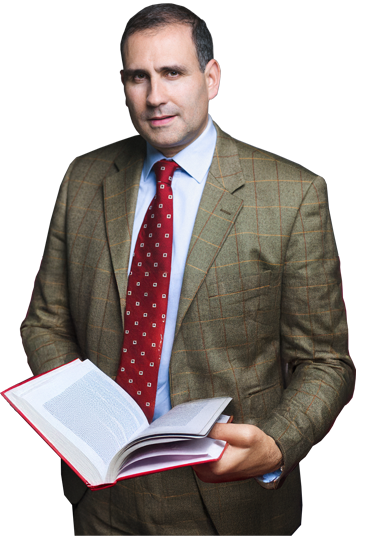
Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Création de l'élevage
Chapitre I – les conditions pour devenir éleveur en France
III – le choix ou l’attribution d’un régime fiscal
A - Imposition des bénéfices résultant de l’exploitation
1°) Imposition des structures d’exploitation directe
Les éleveurs de chiens ou de chatons exerçant sous une structure d’exploitation directe, donc l’entrepreneur individuel et l’EIRL, voient leur bénéfice imposé à l’impôt sur les revenus, dans la catégorie « bénéfice agricole » ou « BA ».
Il existe trois régimes en fonction des seuils des recettes et des options prises par l’exploitant :
Le micro-BA a pris la suite des BA forfaitaires de l’article 64 du CGI à partir de 2016. Le micro-BA dans son principe consiste à appliquer aux recettes de l’exploitation (moyenne triennale), un abattement de 87% pour déterminer le bénéfice agricole. Ce régime présente donc l’avantage d’une tenue de comptabilité allégée, puisque les charges ne sont pas déduites pour leur valeur réelle, mais le sont par l’application d’un taux forfaitaire de 87% sur les recettes réelles.
Les deux régimes de BA réel, quant à eux, impliquent une comptabilité de toutes les charges d’exploitation, en ce qu’aux recettes annuelles, sans calcul de moyenne, on déduit les charges annuelles réelles. Le régime simplifié se distingue du régime normal par le caractère moins détaillé de la déclaration fiscale quant aux postes de charges et de recettes.
L’entrepreneur en EIRL peut opter pour l’impôt sur les sociétés, bien que sa structure ne soit pas sociétaire.
Si l’entrepreneur exerce en parallèle des activités de pension et de dressage, le bénéfice provenant de ces deux activités de services seront également soumis à l’impôt sur les revenus, mais dans la catégorie « bénéfices industriels et commerciaux ».
Cette ventilation n’a mathématiquement pas d’incidence sur le montant de l’impôt sur les revenus, puisque c’est le revenu global qui est imposé. Il se produit donc en pratique une déclaration fiscale de bénéfice agricole, en partant du postulat que les recettes générées par la pension et le dressage étaient accessoires ou connexes. L’administration fiscale n’y trouve en général rien à redire puisque cette organisation comptable n’a pas d’incidence sur le montant final de l’impôt.
2°) Imposition des structures d’exploitation indirecte
Les sociétés passibles de l’impôt sur les revenus, dans la catégorie « bénéfice agricole » pour les ventes de chiens et chats produits, sont en principe les sociétés de personnes :
la SCEA, l’EARL, l’EURL avec un associé unique personne physique, la SARL familiale et la SNC, à la condition évidente de n’avoir pas opté pour l’impôt sur les sociétés. Cette option fiscale est irrévocable et doit se prendre dans les 5 premières années d’exploitation.
Les précisions en supra relatives à la multi-exploitation telle qu’élevage, la pension et le dressage sont valables également pour les sociétés, quant à la nécessité relative d’établir deux comptabilités en vue de deux déclarations de résultat : « bénéfice agricole » et « bénéfice industriel et commercial ».
Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés sont :
L’EURL constituée par un associé unique personne morale, les SARL entre tiers, toutes les SAS et SASU sont obligatoirement soumises à l’impôt sur les sociétés. La SCEA et l’EARL, la SARL familiale et l’EURL associé personne physique peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.
L’impôt sur les sociétés peut se révéler plus avantageux si les résultats sont modestes et/ou si le foyer fiscal de l’éleveur est habituellement imposé dans les tranches supérieures à 33%.
Etant entendu qu’il est conseillé de décliner les résultats, activité par activité, il peut donc être opportun et conforme au droit de créer deux sociétés : l’une pour l’élevage (activité civile puisqu’agricole), l’autre pour la pension, le dressage et la commercialisation de la production (activités commerciales).
Cela présente à la fois l’avantage d’une optimisation fiscale et un avantage de dispersion des risques juridiques et financiers.
On peut imaginer le montage suivant : l’entrepreneur, seul ou en famille, crée une EARL ou une EIRL dédiée à la production de chiots ou de chatons qui seront cédés au prix de gros à une société commerciale SAS, SARL ou EURL, que l’entrepreneur ou son couple, crée et contrôle. Cette société commerciale, soumise à l’impôt sur les sociétés, va ensuite commercialiser au détail la production et faire en parallèle de la pension et du dressage.
Le bénéfice agricole généré par la production-vente de chiots ou de chatons sera en principe modéré. Un éleveur sérieux fait de la sélection rigoureuse des reproducteurs qu’il utilise (dépistage des tares et participation à des épreuves de sélection). Le bénéfice agricole sera imposé à l’impôt sur les revenus dans une tranche en principe basse, à moins que le foyer fiscal de l’entrepreneur perçoive d’autres revenus tels que « traitements et salaires », « bénéfice non-commerciaux », « revenus de capitaux mobiliers » ou encore « revenus fonciers » par exemple.
Puis, le bénéfice de la société SARL ou EURL ou encore SAS, sera quant à lui taxé à 15% jusqu’au seuil de 42 500 €, puis à 25% pour la tranche supérieure à 42 500 €. Pour bénéficier du taux réduit de 15%, la société doit être détenue à 75% par des personnes physiques et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros.
Les associés de la société commerciale ne verront leur impôt sur les revenus augmenté qu’à la condition qu’ils se distribuent le bénéfice de la société commerciale à titre de dividende.
Les acquéreurs de chiots et de chatons seront liés seulement à la société commerciale et non à l’entreprise d’élevage qui détiendra les reproducteurs et les autres actifs tels que locaux, affixe et matériels.
Ces derniers resteront donc à l’abri du gage des créanciers éventuels.
Avec ce montage, la société commerciale, étant en principe une société de services censée posséder peu d’actifs, pourra donc être liquidée sans entrainer avec elle la déconfiture de l’entreprise agricole.
B - l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
La taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, est un impôt de consommation qui touche en principe tous les biens et les services consommés en France. Comme toutes les activités économiques, les opérations agricoles entrent dans le champ d’application de la TVA (Art 63 du CGI).
Toute personne exerçant une ou plusieurs activités agricoles a la qualité d’exploitant agricole. La TVA n’étant pas un impôt réel, mais au contraire un impôt personnel, le critère de détermination est donc la nature de l’opération réalisée.
L’éleveur qui vend sa production animale réalise des opérations agricoles soumises à la TVA, peu importe :
Les exploitants agricoles constituent des assujettis à la TVA. Mais, seuls certains d’entre eux en sont redevables. Ces deux notions engendrent souvent confusion dans l’esprit des contribuables en ce qu’en langage courant, elles revêtent le même sens.
Toutefois, l’autonomie du droit fiscal fait qu’il en est différemment.
En des termes plus courants, l’assujetti est celui qui paye la TVA à l’entreprise qui lui vend le bien ou le service. Les assujettis sont donc les consommateurs dans leurs achats de la vie courante, mais aussi les entreprises, agricoles ou non, qui achètent pour les besoins de leur exploitation des biens et des services. Ce sont juridiquement eux qui sont imposés à la TVA.
Le redevable de la TVA est l’entreprise qui a vendu le bien ou le service et qui a donc collecté la TVA payée par ses clients consommateurs ou professionnels. L’entreprise est donc une collectrice, vouée à reverser la TVA à l’Etat, précisément au Trésor Public, après déduction de la TVA qu’elle a payé dans l’acquisition des biens et services nécessaires à son activité. Le redevable de la TVA est donc l’entreprise qui la collecte.
Il en résulte qu’une entreprise agricole sera toujours assujettie à la TVA et en sera redevable seulement dans deux cas (art 298 bis du CGI) :
Si elle réalise annuellement des recettes agricoles supérieures à 46 000 euros,
Si elle opte à la TVA malgré des recettes annuelles inférieures à ce seuil.
Dans les deux cas, elles relèveront du régime réel simplifié agricole ou RSA.
L’entreprise non soumise à la TVA et qui n’y n’opte pas peut demander annuellement un remboursement forfaitaire de TVA dans la limite d’une assiette de 46 000 euros de recettes agricoles (Art 298 quater du CGI). Il s’agit de compenser forfaitairement la TVA qu’elle a payée dans ses achats nécessaires à son exploitation, sans avoir pu la déduire.
Le taux de la TVA agricole applicable aux opérations de vente de chiots, de chiens, de chats, de chatons est de 20% actuellement. La saillie à titre onéreux, puisqu’elle s’inscrit dans le cycle de croissance des animaux, est une opération soumise à la TVA agricole de 20%.
La pension, le dressage, le transport d’animaux pour le compte de tiers ne sont pas soumises à la TVA agricole, mais à la TVA de droit commun dont le taux est aussi de 20%.