
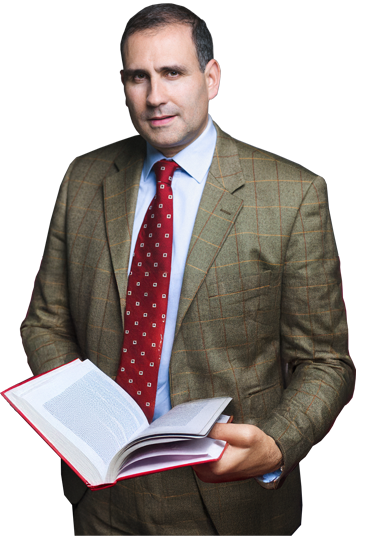
Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Conduite de l'élevage
Chapitre II – Les obligations incombant aux professionnels
I – Les normes d’installations (locaux, milieux ambiants, équipements et agencements)
Les obligations en matière de locaux, d’équipements et d’agencements sont posées dans leur principe par l’article R. 214-29 du code rural et dans leur mise en œuvre par les arrêtés pris par le Ministre en charge de l’Agriculture les 25 octobre 1982 et 03 avril 2014.
Article R. 214-29 du code rural :
« Les activités mentionnées aux articles à doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité. »
Si les arrêtés du 02 juin 1975 et du 30 juin 1992 ont été abrogés, l’esprit du dernier d’entre eux persiste dans l’arrêté du 3 avril 2014, qui remet donc l’accent sur la facilité d’entretien (lavage et désinfection), la préservation contre le froid, la chaleur et la fugue, s’agissant des logements abritant les animaux.
La réunion de ces propriétés dans les installations et les matériels fait partie des points particulièrement vérifiés lors des contrôles des chenils et des chatteries par les agents des DDPP et DDETSPP.
Les normes d’installation et de milieux ambiants imposées aux professionnels par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture du 3 avril 2014 figurent en ses annexes qui sont de véritables cahiers des charges dont aucune norme n’est à négliger.
Comme tout arrêté d’application, ses dispositions vont du général au spécifique, autrement dit du sens large à la précision, d’où parfois certaines redondances.
Ainsi l’annexe I porte sur les dispositions générales applicables à toute espèce et à toute activité, alors que l’annexe II va traiter des normes spécifiques à chaque espèce et à chaque activité.
La présentation faite ici consiste davantage en un recensement synthétisé par thème : « locaux », puis « obligations sanitaires », et enfin « obligations administratives », avec une distinction entre chien et chat.
A – l’Etablissement, ses locaux et ses équipements
1°) Normes de conception générales
S’agissant d’abord des normes d’installations des établissements, le chapitre 1 de l’annexe I de l’arrêté prévoit que :
« 1/ Les établissements doivent être conçus de manière à :
a) protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
b) répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues en permettant une maîtrise de la reproduction ;
c) prévenir la fuite des animaux ;
d) faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
e) permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l’espace et/ou dans le temps ;
f) faciliter par leur agencement l’observation des animaux. »
Pour répondre à ces exigences de conception, l’arrêté du 03 avril 2014, toujours dans ses annexes, énonce avec une précision progressive la nature des installations et des équipements avec leurs normes techniques.
2°) Normes de logement des animaux
Les annexes de l’arrêté prescrivent que le chenil ou la chatterie doit disposer de locaux, d’installations et d’équipements appropriés pour assurer hébergement, abreuvement, alimentation, confort, libre mouvement, sécurité, et tranquillité des animaux.
a) Pour les chiens et les chats
L’arrêté du 3 avril 2014, en son annexe I, chapitre 1er Installations des établissements prévoit en outre que :
1/ L’établissement doit être approvisionné en eau potable et disposer d’un lave-main alimenté en eau chaude et en eau froide.
Cette précision peut paraître évidente. Mais il existe, malheureusement, des chenils improvisés et donc voués à la fermeture, non-pourvus en eau potable et que les exploitants pensent pouvoir alimenter avec des citernes ou encore par des récupérateurs d’eau pluviale.
De plus, les locaux où sont manipulés les animaux doivent être dotés d’un dispositif de lavage hygiénique des mains, tel que distributeur de gel hydro-alcoolique ou savon liquide désinfectant à usage médical.
3/ l’établissement doit disposer de locaux secs, propres, à bonne température et à l’abri des nuisibles, pour l’entreposage des denrées et matériels périssables tels que l’alimentation, les médicaments, les litières et les produits de nettoyage et de désinfection.
4/ l’établissement doit disposer d’un réseau d’assainissement non-collectif (fosse toutes eaux, microstation ou filière compacte) ou d’un raccordement au réseau d’assainissement communal.
Les éleveurs visés à l’article 2 de l’arrêté ne sont pas astreints à cette obligation au titre de la protection animal recherchée par le droit agricole ou rural. Cependant, ils y restent tenus au titre de la protection de l’environnement tel que vu au Titre I, Chapitre II, § III du présent guide et dont on rappelle les références textuelles : code de l’environnement Livre I, Titre II, arrêtés des 8 décembre 2006 et 22 octobre 2018 sur les ICPE et le RSD pour la salubrité.
5/ l’établissement doit être doté de systèmes de détection (détecteurs de fumée) et de lutte contre les incendies (extincteurs ou lance à incendie), mais aussi d’un congélateur avec serrure pour le stockage temporaire des cadavres. Les éleveurs visés à l’article 2 de l’arrêté n’y sont pas astreints. Ces derniers doivent, en cas de décès, requérir l’enlèvement sans délai du cadavre par un équarisseur ou procéder à son dépôt chez un vétérinaire.
6/ si l’établissement emploie du personnel, il doit mettre à leur disposition des vestiaires équipés de lave-main et de toilettes.
7/ L’arrêté du 3 avril 2014, toujours en son annexe I, mais au chapitre III Gestion sanitaire précise que tous les locaux, installations fixes ou mobiles, les équipements et le petit matériel employés pour le soin des animaux sont maintenus en parfait état d’entretien et de propreté. Le circuit de nettoyage est organisé de manière à séparer les flux propres des flux sales (la méthode de la marche en avant).
Il y a dans ces deux dernières prescriptions deux points particulièrement contrôlés par les DDPP : une propreté de tous les instants et un nettoyage efficace (non auto-souillant).
Le terme « soin » aux animaux est détaché de toute connotation médicale. Il faut entendre par soin, tous les soins au sens large : abreuvement, alimentation, logement, couchage.
Ceci sous-entend qu’en permanence les écuelles, les sols, les niches, les bancs de couchage, les panneaux de chenil doivent être propres. Les déjections sont donc censées être ramassées en temps réel et les sols lavés autant que nécessaire.
8/ Obligation de cloisonnement entre les locaux de pension avec ou sans dressage et les locaux d’élevage pour les établissements où s’exercent cumulativement ces activités. Le texte parle de locaux bien séparés. Cette séparation peut résulter d’une distance ou d’un cloisonnement présentant des garanties d’étanchéité quant à la volatilité des microbes.
On évite en effet de mélanger les animaux à présence temporaire (en pension, en dressage ou en garde) avec les animaux permanents de l’élevage mêmes adultes. Ils n’ont pas le même microbisme.
D’une manière générale et donc y compris au sein d’un même groupe (élevage ou pension), toutes les mesures ou les précautions doivent être prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux contagieux et animaux sains.
Puis, toujours au sujet des normes d’hébergement des animaux, l’annexe II de l’arrêté du 03 avril 2014 vient préciser les normes techniques, espèce par espèce :
b) Pour le chien :
Il est une disposition si importante à connaître par un professionnel que nous la reproduisons littéralement ci-après :
« Les chiens disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol » (donc niche surélevée ou banc de couchage).
Concrètement et précisément, dans les logements des animaux, le sol, les murs et les autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non-toxiques, facilement lavables et désinfectables.
Le sol doit être non-glissant, non-abrasif, uniforme, plein, continu et doit pouvoir supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile. Sa conception doit permettre un nettoyage facile et l’évacuation efficace des eaux de lavage pour tout système approprié, tel qu’un caniveau d’évacuation vers la fosse toutes eaux.
En redondance avec l’arrêté du 25 octobre 1982 qui reste en vigueur et applicable à tout détenteur quel qu’il soit, l’arrêté du 3 avril 2014, toujours en son annexe II, section 1ère chapitre 1er, fixe lui-aussi les normes d’espace minimal d’hébergement canin à 5 m² pour la surface au sol et à 2 m pour la hauteur de l’enclos, avec la précision que « tout ou partie de cet espace d’hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Cet espace minimal peut être exceptionnellement réduit pour les séjours de l’animal malade ou blessé dans les locaux d’isolement, mais uniquement pour le temps du traitement.
Pour les chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot, la surface d’hébergement minimal est doublée et ne peut donc être inférieure à 10 m², mais peut toutefois accueillir deux chiens.
Les chiots non-sevrés peuvent être hébergés dans ces surfaces minimales avec leur mère, soit 5 m² ou 10 m² selon la taille au garrot de la lice. Quant à la précision de l’âge du sevrage, s’agissant d’un arrêté pris par le Ministre de l’Agriculture, il s’entend au sens biologique (8 semaines) et non au sens environnemental pour les ICPE (moins de 4 mois).
Il ne serait décemment pas concevable qu’une chienne d’un gabarit de moyen à grand (épagneul breton à braque allemand par exemple) soit détenue avec ne serait-ce que trois de ses chiots, âgés de 3 mois et demi, dans un espace de 5 m²…
c) Pour le chat :
A l’instar du chien, les chats bénéficient de la même prescription générale quant à leur hébergement :
« Les chats disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol ».
L’espace minimal requis pour l’hébergement des chats est de 2 m² par chat. Tout ou partie de cet espace d’hébergement est abrité des intempéries et du soleil. On ne parle plus de surface comme pour les chiens, mais d’espace. Ce dernier peut être réduit pour les séjours dans les locaux d’isolement le temps du traitement du sujet malade.
Le sol des logements est plein et continu.
L’espace d’hébergement dispose de plates-formes à différents niveaux en nombre suffisant afin d’offrir à chaque chat une aire de repos et d’observation et une possibilité de rester à distance de ses congénères. La surface des plates-formes permettant le couchage est comptabilisée dans les 2 m² par chat, ce qui fait que certains chalets à chats ont des superficies au sol inférieures à 2 m².
Les chatons non-sevrés peuvent être hébergés dans cet espace minimal avec leur mère.
Les chats doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils peuvent se dépenser et jouer en tant que de besoin quotidiennement.
3°) Normes relatives aux autres locaux de l’établissement
a) L’établissement doit disposer d’une infirmerie, consistant en un local séparé à l’écart du secteur sain que constituent les bâtiments abritant les boxes de pension, d’élevage et de maternité, eux-mêmes séparés les uns des autres.
Le local d’infirmerie doit permettre de traiter un animal dans de bonnes conditions. Il doit être chauffé et contenir à minima : une table d’examen, une pharmacie de premiers soins et de traitement des affections bénignes et un ou plusieurs boxes avec couchage confortable. Le ou les animaux ne doivent pas pouvoir accéder aux matériels de l’infirmerie, d’où la nécessité de boxes à l’intérieur du local ou du bâtiment d’infirmerie.
Certaines DDPP ou DDETSPP tolèrent dans les chenils à faibles effectifs, l’absence de local d’infirmerie, si figure dans le règlement sanitaire de l’établissement, la consigne consistant à emmener chez le vétérinaire un animal dès les premiers signes d’une maladie.
b) Les locaux de mise bas ou maternités sont isolées de tous les autres bâtiments. Le local de mise bas ou maternité doit être conçu de manière à ce que la mère puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou sur une aire plus élevée disposant d’une couche confortable, à l’écart de sa progéniture. Le local de mise bas ou maternité doit pouvoir être chauffé graduellement pour assurer confort et sécurité à la mère et à sa progéniture. (Arrêté du 3 avril 2014, annexe II, chapitre II de la section 2).
Les parcs d’ébat des femelles allaitantes sont également distants des aires de détente des autres animaux.
c) Un local de quarantaine ou d’observation, qui résulte du 2ème point du chapitre 4, annexe I, lequel prévoit que les animaux apparemment sains sont transférés dans les installations, préalablement nettoyées, désinfectées et s’il y a lieu laissées (NDLA : préalablement) en vide sanitaire, pour y subir une période d’acclimatation et d’observation sans mélange de lots de provenance différente. La durée de cette période est définie en collaboration avec le vétérinaire sanitaire et indiquée dans le règlement du même nom, ainsi que le prévoit l’article R 214-30 du code rural sur le contenu du règlement sanitaire interne.
d) un emplacement pour inspecter les animaux à introduire dans l’établissement. Cet emplacement peut être une cour tenue à l’écart, l’infirmerie, ou le local de quarantaine ou d’observation. (Annexe I, chapitre 4, 1er point).
En d’autres termes, le chien pris en pension ou le chien acquis pour l’élevage ne doit intégrer la zone pension ou la zone élevage qui le concerne que s’il ne semble pas présenter de signe de maladie contagieuse.
Il commencera donc par intégrer un box d’isolement ou de quarantaine pour une période d’observation durant laquelle il ne sera pas sorti avec les autres individus (Annexe I, chapitre 4, 2ème point).
B – le Milieu ambiant pour les animaux
Les normes de milieux ambiants font l’objet du chapitre 2 de l’annexe I de l’arrêté du 3 avril 2014 qui prévoit que :
a) Pour les chiens et les chats :
1/ les animaux ne peuvent être détenus constamment dans l’obscurité ou dans la lumière. Ils doivent donc bénéficier de cycles de luminosité alternés naturellement, y compris les jours de fermeture de l’établissement.
2/ Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont accès quotidiennement à des contacts sociaux avec les chiots et chatons de la même portée, avec des sujets adultes et des humains.
Ils doivent être familiarisés avec les conditions environnementales qu’ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement.
La séparation des chiots de leur mère doit se faire progressivement et ne peut intervenir avant l’âge de six semaines, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire (Arrêté du 3 avril 2014, annexe II, chapitre II de la section 2).
3/ Les locaux doivent disposer :
4/ L’ensemble des installations et dispositifs doivent faire l’objet d’une surveillance quotidienne et d’un entretien régulier.
5/ Les éventuels systèmes automatiques tels qu’abreuvement ou nourrissage doivent être accompagnés de dispositifs de surveillance et d’alarme pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dysfonctionnement, y compris les jours de fermeture. En cas d’absence de tels dispositifs, des procédures de surveillance renforcée doivent être mise en œuvre et matérialisées par la tenue d’un planning émargé.
6/ Des procédures de secours doivent être prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne des équipements nécessaires à leur bien-être.
7/ Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence sont connues et affichées bien en vue du personnel (par exemple, la procédure en cas d’accident ou de blessure, les méthodes et les matériels pour interrompre une rixe entre chiens).
Puis, l’annexe II de l’arrêté du 3 avril 2014 apporte des dispositions plus précises, espèce par espèce.
b) Pour les chiens :
Les dispositions spécifiques figurent au chapitre I dispositions spécifiques aux chiens de la section 1 de l’annexe II.
Elles rappellent d’emblée que les hébergements des chiens doivent être isolés thermiquement (cf. disposition reproduite en supra).
Elles précisent plus loin qu’hormis les installations construites avant le 17 avril 2014, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 avril de la même année, les chiens ont accès en permanence à une courette en plein air dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race. Ils doivent pouvoir s’y mouvoir librement, sans entrave et sans gêne.
La tenue à l’attache ne peut se faire autrement que ponctuellement et dans les limites fixées par l’arrêté du 25 octobre 1982 (voir en supra).
C’est de cette disposition que la conception du box le plus répandu s’est faite, à savoir un box de 10 m², composée d’une partie « nuit » abritée et isolée de 2m² (généralement sous bâtiment) avec accès direct, par une porte coulissante verticalement, dite « porte guillotine », dotée ou non d’un battant souple, à une courette extérieure de 8m², abritée partiellement, voire non abritée.
Le sol de l’espace d’hébergement et des courettes doit être entretenu pour ne pas être source de nuisances (olfactives), de risque sanitaire et pour garantir les conditions de bien-être des chiens.
Des dispositifs et des accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation (lutter contre l’ennui qui est une source de troubles du comportement) et le jeu.
Tous les chiens, excepté les sujets malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quel que soit leur âge et leur mode de détention, doivent être sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu’ils puissent s’ébattre et jouer entre eux, ainsi qu’en interaction avec l’humain.
Un parc d’ébats ou une aire d’exercice est mis à leur disposition. Cette obligation est d’une importance telle qu’un tableau des sorties est affiché ou communicable aux agents de contrôle (DDPP).
Dans la même optique, les chiens doivent être hébergés autant que possible en groupes sociaux harmonieux (entre congénères compatibles), sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.
Le tenant du chenil doit prendre des précautions particulières lors du regroupement des chiens ou de l’introduction d’un nouveau chien dans un groupe. Il doit surveiller régulièrement que la compatibilité des chiens entre eux reste effective. Cette obligation rend responsable envers les clients et propriétaires des chiens, le gérant de pension ou le dresseur en cas de blessure ou de décès causés par un conflit entre chiens.
Les chiens doivent bénéficier quotidiennement de contacts interactifs positifs avec des êtres humains et des congénères. L’arrêté insiste sur la nécessité de veiller attentivement à la socialisation et à la familiarisation des chiens.
c) Pour les chats :
Les dispositions spécifiques aux chats sont édictées au chapitre II Dispositions spécifiques aux chats, de la section 1 de l’annexe II de l’arrêté du 3 avril 2014.
Elles rappellent d’emblée que les hébergements des chats doivent être isolés thermiquement (cf. disposition reproduite en supra).
Le sol de l’espace d’hébergement doit être conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et pour garantir les conditions de bien-être des chats.
Les chats disposent de couches confortables, de griffoirs, de bacs à litière en nombre suffisant et d’une superficie adaptée, garnis d’une litière adéquate et absorbante. Des dispositifs et des accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu.
Les chats sont hébergés, autant que possible, en petits groupes d’individus compatibles, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.
Des précautions particulières sont nécessaires lors du regroupement des chats ou de l’introduction d’un nouveau chat dans un groupe. Dans tous les cas, la compatibilité sociale au sein des groupes fait l’objet d’une surveillance particulière.
Tous les chats bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de contacts interactifs positifs avec des humains.