
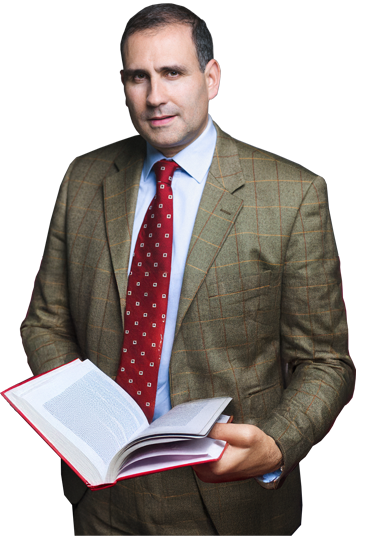
Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Création de l'élevage
Chapitre II – le choix des locaux et les règles d’implantation
IV – Les effets du respect des normes environnementales à l’égard des tiers
Ainsi que cela a été indiqué en supra, un chenil, même tenu rigoureusement, peut être vecteur d’émergences sonores ou olfactives et susciter des plaintes du voisinage.
La commodité du voisinage en matière de nuisances sonores est protégée par l’article R. 1336-5 du code de la santé publique qui dispose que :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »
Les élevages, les pensions et les détenteurs de chiens en général ne sont pas pour autant soumis au dictat de voisins intolérants au bruit, tant le droit exige un caractère excédant les troubles normaux du voisinage, procure une présomption de normalité pour les chenils hors ICPE voire une immunité pour les ICPE.
L’article R. 1336-4 du même code pose le principe que les nuisances sonores qui relèvent d’une réglementation spécifique, telle que celles des ICPE, ne sont pas concernées par le régime juridique des bruits de voisinage.
A – Le critère d’excessivité des émergences en provenance de chenils hors ICPE
1°) le droit positif et son évolution
La Cour de cassation est venue tempérer l’incrimination édictée à l’article R 1336-5 du code de la santé publique, en ayant posé l’exigence d’un caractère excessif, autrement-dit d’un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage, par son arrêt de principe rendu par sa 3ème chambre civile le 24 octobre 1990 (Cass civ 3ème - 24 octobre 1990).
Il faut entendre par troubles normaux de voisinage, ceux auxquels une personne raisonnable et normalement constituée peut s’attendre dans un environnement déterminé.
Il y a donc dans ce principe à la fois un critère d’excessivité et à la fois un critère de localisation, ce dernier s’appréciant in concreto, c’est-à-dire au cas par cas et donc en fonction des circonstances.
La jurisprudence est aussi foisonnante que contradictoire, dans le contentieux du voisinage au sujet des aboiements de chiens.
En cas de litige et jusqu’au 15 avril 2024, le juge devait apprécier l’excessivité des émergences sonores par rapport à l’environnement dans le périmètre duquel elles parvenaient (village, zone rurale agricole, proximité d’autres sources de nuisances) et devait bien entendu s’assurer de leur provenance (chiens, canards, volailles, chevaux, outils, machines…).
La preuve se faisait par tout moyen : témoignages, rapport de police (municipale ou nationale) ou de gendarmerie, constat de commissaires de justice, expertises. Ces procédés revêtaient les inconvénients de partialité pour la preuve testimoniale, de subjectivité, d’imprécision et d’inconstance temporelle pour les autres moyens.
Pour une meilleure pratique et plus de fiabilité, un décret numéroté 2017-1244 daté du 07 août 2017 dit « décret bruit » est venu ajouter notamment deux articles R. 1336-6 et R 1336-7 au code de la santé publique afin de permettre de déterminer plus objectivement l’intensité des bruits qui pourraient être qualifiés d’excessifs par un plaignant.
Ces dispositions prévoient que si le bruit incriminé a pour origine une activité professionnelle, telle un élevage ou une pension, l’atteinte à la tranquillité d’autrui ou à la santé de l’homme serait caractérisée si l’émergence globale sonore excédait les seuils fixés à l’article R. 1336-7 et qui sont, avant pondération, de 5 décibels le jour et de 3 décibels la nuit.
L’article R 1336-6 pose opportunément comme base de comparaison la juste prise en considération du niveau sonore ambiant, dans la détermination de l’impact réel d’une émergence d’un bruit en particulier, appelée « émergence globale ».
Les articles R. 1336-8 et R. 1336-9, créés également par le décret « bruit », définissent quant à eux les modalités de mesure et de calcul de l’émergence globale.
La jurisprudence antérieure à 2017 départageait les parties par le bon sens et par l’appréciation du juge de la pertinence des preuves qui lui étaient soumises.
Un chenil de 9 chiens était plus facilement considéré comme légitime en milieu rural, village y compris, qu’en centre-ville.
Il a déjà été jugé que la détention de plusieurs chiens de chasse dans un village rural n’était pas en soi une anormalité, alors que la possession par un particulier, non-éleveur d’animaux de basse-cour, d’un coq chantant tous les jours à 5 heures du matin au cœur d’un village rural, n’avait rien d’impérieux et pouvait donc être considéré comme un trouble anormal de voisinage.
Que ce soit pour les bruits d’activités (élevage, pension ou dressage) ou pour les bruits de voisinage (détenteur particulier), le critère acoustique est celui de l’émergence, définie comme étant la différence arithmétique entre le niveau sonore incluant le bruit particulier (l’installation bruyante) et le niveau sonore existant hors bruit particulier.
Il s’agit en fait d’un comparatif entre bruit ambiant et bruit aggravé par l’émergence incriminée.
Compte tenu des contraintes d’établissement objectif d’une émergence sonore, il importe de ne jamais reconnaître par écrit ou devant témoin que son chenil est bruyant tant que l’étude nécessaire n’a pas encore été effectuée.
Car, c’est au plaignant de prouver l’émergence et surtout son caractère excessif. Or, la tolérance au bruit est subjective, alors que son excessivité reste objective ou du moins doit le rester.
La loi n° n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à réduire les actions judiciaires intentées par des néoruraux contre des agriculteurs, a recrée l’article 1253 du code civil et crée l’article L. 311-1-1 du code rural.
Ces deux textes protègent l’agriculteur en plus et d’abord par l’antériorité de son activité contre les réclamations de voisins dont les titres de jouissance lui sont postérieures.
Cette protection additionnelle ne vaut que pour les agriculteurs, donc pour les éleveurs, et non pour les pensions ou les dresseurs stricto-sensu.
Toujours est-il que la meilleure protection contre les plaintes du voisinage en raison des nuisances reste l’éloignement du chenil des habitations tierces.
L’éloignement dont on garde la maîtrise est celui obtenu par une distance d’isolement, plutôt que par une distance d’éloignement.
La distance d’isolement est la distance qui sépare la localisation du chenil du lieu le plus proche où un tiers pourrait venir édifier une habitation ou un local recevant du public.
Par exemple, le chenil de 9 chiens aura intérêt à s’installer sur une parcelle d’un hectare, si la parcelle voisine est constructible. Ainsi, en cas de construction d’une maison voisine, la distance de 50 mètres serait en toute circonstance respectée.
A l’inverse, la distance d’éloignement est quant à elle conjoncturelle. On peut s’installer sur une parcelle sans mitoyenneté habitée. Mais, si un tiers venait à résider sur l’une des parcelles voisines, la distance de 50 mètres pourrait ne plus être respectée.
Puisque l’élevage non-ICPE ne bénéficie pas de la règle de réciprocité d’éloignement consacrée à l’article L. 111-3 du code rural, le législateur a promulgué la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 qui y pallie différemment.
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024, visant à réduire la recrudescence des actions judiciaires intentées pour trouble de voisinage à l’encontre d’agriculteurs par des néoruraux, a recrée l’article 1253 du code civil et institué l’article L. 311-1-1 du code rural.
Article 1253 du code civil ((L. no 2024-346 du 15 avr. 2024) : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ».
Article L. 311-1-1 du code rural « (L. no 2024-346 du 15 avr. 2024, art. unique-III) : « La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité ».
La protection apportée par ces articles 1253 et L. 311-1-1 est utile aux chenils non-ICPE seulement. Car, une ICPE renfermant des chiens est astreinte, par l’arrêté ministériel qui la concerne, au respect de seuils d’émergences sonores pour être en conformité avec la réglementation. Or, si une ICPE régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée par la DDETSPP respecte les normes sonores qui la concernent, son antériorité ne lui est d’aucune utilité. L’ICPE est protégée contre les réclamations par son seul statut d’ICPE. Si en revanche, l’ICPE outrepasse les seuils par son fonctionnement, son antériorité ne la protège pas.
2°) Répression contre les chenils professionnels hors ICPE
En matière de bruits d’activités, l’article R. 1336-11 du code de la santé publique renvoie à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Par leurs dispositions, ces articles confèrent à l’administration, et donc à la DDPP pour un élevage professionnel ou pour une pension, tous deux non-ICPE (chenil < à 10 chiens), le pouvoir de contraindre l’exploitant à prendre les mesures nécessaires à la réduction des nuisances dans les normes fixées par les articles R. 1336-7 et suivants du code de la santé publique, s’il a été établi que les aboiements excédaient les limites d’émergence fixées par le décret dont ces articles sont issus.
En cas de résistance du fauteur de troubles, la DDPP dispose de pouvoirs tels que la suspension de l’exploitation, de mise en œuvre des travaux par un tiers et de condamnation à une amende administrative pouvant atteindre la somme de 15 000 euros.
3°) Répression contre les simples détenteurs de chiens (les particuliers)
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique proscrit le bruit de voisinage. Sa seule transgression se poursuit par une action exclusivement civile.
Vis-à-vis d’un simple détenteur de chiens, un particulier qui n’élève ou ne garde pas de chiens, c’est le Maire de la commune qui a autorité. Les éventuelles réclamations devront donc être adressées au Maire, lequel, outre avoir la prérogative d’endiguer tout conflit de voisinage par application de l’article L. 2212-1 du code des collectivités territoriales, a surtout celle de veiller au respect des éventuels arrêtés, du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et du RSD (Règlement Sanitaire Départemental) dans sa commune.
Le Maire peut déléguer enquêtes et constatations à la police municipale, en charge par délégation de la tranquillité publique, si la municipalité s’est dotée d’un tel service.
Lorsque les bruits de voisinage deviennent des bruits de comportement, tels que laisser durablement des chiens aboyer, on parle alors de bruits provoqués. Ils sont punissables pénalement. Dans ce dernier cas, il n’est pas obligatoire de s’adresser préalablement au Maire, les forces de l’ordre sont compétentes pour constater les agissements (Police nationale, Gendarmerie nationale et Police municipale) et dresser procès-verbal.
L’article R. 623-2 du code pénal prévoit et réprime la contravention de 3ème classe que constitue le bruit le jour et le tapage la nuit. Sa transgression est réprimée au pénal en principe puisqu’elle implique un acte volontaire malveillant, mais peut l’être uniquement au civil, si la victime décidait seule, indépendamment de l’intention du Ministère public, de poursuivre le responsable des aboiements.
La répression des bruits de comportement diffère selon que les bruits se produisent le jour ou la nuit.
Durant le jour, un bruit peut devenir un trouble de voisinage, s’il est intensif, répétitif ou prolongé dans la durée.
S’il se produit la nuit, les critères d’intensité, de durée et de répétition ne sont pas exigés pour matérialiser le délit de tapage nocturne. En revanche, il faut prouver que le responsable du bruit avait conscience de sa manifestation et n’a pas sérieusement entrepris d’endiguer son phénomène. La nuit, le bruit doit être audible depuis l’intérieur du logement du plaignant.
Les forces de l’ordre ont le pouvoir de recourir au système répressif de l’amende forfaitaire, dont le montant minoré est de 68 euros si le paiement intervient dans les 45 jours de l’avis de contravention, ou de 180 euros en cas d’amende majorée.
Cependant, police et gendarmerie peuvent se contenter de transmettre leur dossier d’enquête au Procureur de la République, lequel appréciera l’opportunité de traduire le mis en cause, surtout s’il est récidiviste, devant une juridiction répressive aux fins de requérir à son encontre, outre une amende, une peine complémentaire telle que la confiscation du bien employé pour commettre l’infraction, à savoir le ou les chiens.
Bien entendu, la victime de ces agissements est recevable à solliciter réparation pécuniaire du préjudice subi par les aboiements soit directement devant le juge civil, soit en se constituant partie civile lors du procès pénal intenté par le Procureur de la République au détenteur des chiens.
B – Présomption d’absence de nuisances par le respect des normes sanitaires
Les Règlements Sanitaires Départementaux (RSD) disposent que les tiers ne peuvent se prévaloir des éventuels inconvénients (bruits et odeurs) occasionnés au voisinage par les établissements d’élevage, dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément aux prescriptions du RSD et à celles des réglementations en vigueur.
Le respect des normes sanitaires procure à l’exploitant du chenil une présomption d’absence de nuisances.
Ce principe sous-entend la garantie d’une jouissance paisible contre les recours des tiers du seul fait des nuisances, si l’implantation s’est effectuée dans les règles.
De plus, le caractère universel de la source textuelle, le RSD, implique l’extension de ce principe aux chenils ne ressortant pas des ICPE, à savoir les chenils de 9 chiens au plus.
C – Immunité de l’exploitant d’un chenil ICPE
S’agissant de la lutte contre les bruits émis, les arrêtés ministériels relatifs aux trois régimes d’ICPE renfermant des chiens (déclaration, enregistrement et autorisation) prévoient les mêmes prescriptions en matière de bruits :
« L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Toutes les précautions sont prises pour éviter aux animaux de voir directement la voie publique ou toute sollicitation régulière susceptible de provoquer des aboiements, à l’exclusion de celles nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
Les animaux sont rentrés chaque nuit dans les bâtiments, ou enclos réservés.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d’émergence en application de .
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
pour la période allant de 7 heures à 22 heures :
| DURÉE CUMULÉE d’apparition du bruit particulier T | ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB(A) |
|---|---|
| T < 20 minutes | 10 |
| 20 minutes <= T < 45 minutes | 9 |
| 45 minutes <= T < 2 heures | 7 |
| 2 heures <= T < 4 heures | 6 |
| T >= 4 heures | 5 |
pour la période allant de 22 heures à 7 heures : émergence maximale admissible : 3 dB(A).
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite ».
A l’incrimination posée par l’article 1336-5 du code de la santé publique, l’exploitant d’un chenil consistant en une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) régulière et reconnue, peut opposer à toute plainte d’un tiers pour nuisances sonores, les dispositions de l’article R. 1336-4 du même code :
« Les dispositions des s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie… »
Pour passer outre cette immunité, le tiers devra prouver que les émergences de bruits en provenance de l’ICPE excèdent les limites fixées par l’arrêté ministériel propre au régime de l’ICPE considérée (arrêtés des 08/12/2006 et 22/10/2018), mais aussi celles de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE, pour l’ICPE soumise à autorisation seulement, excepté le point 1.9 de son annexe qui est commun aux trois régimes d’ICPE renfermant des chiens.
Cet arrêté fixe en effet les limites d’émergence concernant le fonctionnement des installations classées pour la protection de l’environnement et détermine la méthodologie des mesures des émissions sonores.
La réclamation doit être adressée à la DDPP en sa qualité d’autorité de contrôle des ICPE.
Les limites de bruits d’activités fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatives aux ICPE sont évidemment beaucoup plus élevées que celles fixées par le décret « bruit » du 07 août 2017, codifié aux articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, relatif aux bruits de voisinage.
D – La protection des chenils ICPE par la règle de la réciprocité d’éloignement
La localisation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) influence les documents d’urbanisme puisque la réalisation des études de dangers peut servir de référence pour le zonage en matière d’urbanisme.
A l’instar d’un monument historique, une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) figurera dans la réponse à une demande de renseignements d’urbanisme et à fortiori sur le certificat d’urbanisme d’une parcelle située dans son périmètre.
L’article L. 111-3 du code rural consacre la règle de réciprocité exclusivement pour les ICPE catégorisées « Elevage » ou « Chenil », en disposant que :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non-agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes »
Cette règle consiste en somme à interdire aux tiers de construire un bâtiment d’occupation par l’humain dans un rayon de moins de 100 mètres autour du chenil.
Les ICPE figurent aux fichiers d’urbanisme tels que le cadastre. Il en résulte que l’existence d’un élevage ou d’un chenil fera échec à la délivrance d’un permis de construire demandé par un tiers pour l’édification, dans un périmètre de 100 mètres du chenil, d’un bâtiment à usage d’occupation par l’humain.
L’administration peut prescrire dans ses arrêtés d’enregistrement ou d’autorisation des distances d’isolement, si les circonstances le justifient.
Par exemple, si l’étude d’impact ou l’avis d’un tiers faisaient ressortir qu’en raison de vents dominants, le voisinage resterait incommodé par les nuisances, malgré l’observation de la distance d’éloignement des 100 mètres.