
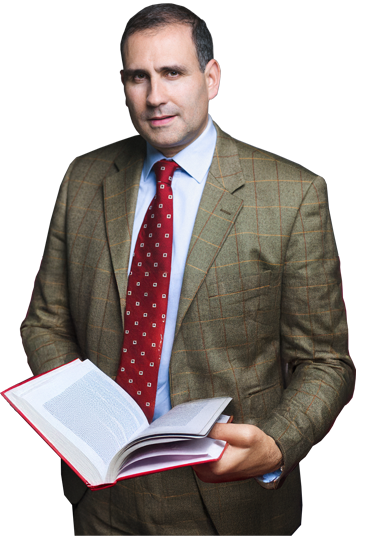
Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Création de l'élevage
Chapitre I – les conditions pour devenir éleveur en France
IV – L’adhésion presque toujours obligatoire aux régimes de protection sociale (la MSA)
Les différents régimes de protection sociale des agriculteurs non-salariés, de leurs ayants-droits et salariés, sont regroupés au sein d’une seule caisse, qui se veut guichet unique. Il s’agit de la mutualité sociale agricole, plus connue sous le sigle de MSA.
De par le montant annuel des prestations qu’elle verse (26,9 milliards d’euros) chaque année, la MSA est le deuxième régime de protection sociale en France. Elle garantit l’assurance maladie « Amexa » (santé & maternité), l’assurance invalidité, les assurances vieillesse « AVI » et « AVA » (retraite), et l’assurance famille « PFA » (veuvage, famille, logement). La MSA encaisse toutes les cotisations et contributions sociales, y compris celles relatives à l’assurance chômage par délégation.
L’adhésion à la MSA est obligatoire pour l’immense majorité des agriculteurs non-salariés et des entrepreneurs de travaux agricoles (Articles L. 722-1 à L. 722-5-1 du code rural).
En effet, pour être dispensé d’assujettissement à la MSA, l’éleveur doit avoir une activité qui ne dépasse aucun des trois seuils énumérés à l’article L. 722-5 du code rural :
A - le statut de chef d’exploitation
L’éleveur sera assujetti en tant que chef d’exploitation toutes les années où au 1er janvier il aura possédé au moins 8 femelles reproductrices, conformément à l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors-sol.
Une femelle reproductrice est une femelle en âge de reproduire et ayant déjà reproduit. Selon les races, l’âge maximal est compris entre 7 et 9 ans inclus.
Si l’éleveur exerce en plus de la production une activité de prolongement, telle que la commercialisation, assujettie en temps de travail, il doit justifier d’une durée annuelle d’au moins 1200 heures de travail au total pour les deux activités : production et commercialisation.
Le temps passé à des épreuves de sélection des reproducteurs : expositions et concours de travail ne compte pas pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Si l’éleveur ne remplit pas les conditions pour être affilié en tant que chef d’exploitation, il peut néanmoins être rattaché à la MSA en tant que cotisant de solidarité (voir en infra).
Le chef d’exploitation ou d’entreprise de travaux agricoles à titre principal ou exclusif, âgé de 18 à 40 ans bénéficie durant les 5 premières années d’affiliation d’une exonération partielle et dégressive des cotisations par le dispositif « exonération jeune agriculteur ».
Cette exonération ne vaut que pour les cotisations sociales du chef d’exploitation ou d’entreprise de travaux agricoles. Elle ne s’applique donc pas aux cotisations qui peuvent être dues au titre d’un conjoint collaborateur ou de salariés.
L’exonération ne s’applique pas non plus aux cotisations des assurances accident du travail et maladie professionnelle (ATEXA), de la caisse de retraite complémentaire (RCO), à la CSG et au CRDS, à la contribution à la formation professionnelle et à la FMSE.
B - le statut de cotisant de solidarité
De par le dispositif, mis en place par la loi du 13 octobre 2014, d’activité minimale d’assujettissement (AMA), codifié aux articles L. 722-5 et L. 722-5-1 du code rural, les petits éleveurs peuvent être rattachés à la MSA, non pas en qualité de chef d’exploitation, mais en celle de cotisant de solidarité.
Pour y prétendre, il faut justifier de :
Pour devoir payer la cotisation de solidarité, il faut déclarer à la MSA des revenus agricoles ni nuls, ni déficitaires. La cotisation annuelle est calculée sur la base du revenu de l’année précédente. La base de calcul pour la première année est forfaitairement de 100 fois le SMIC. Elle se régularise par la suite sur le revenu réel lorsque le cotisant le déclare.
A la cotisation de solidarité, l’éleveur devra ajouter les cotisations aux assurances accident du travail et maladie professionnelle (ATEXA), à la caisse de retraite complémentaire (RCO), à la CSG, au CRDS, à la contribution à la formation professionnelle et à la FMSE.
Depuis le 1er janvier 2016, on devient éleveur professionnel, dès la première portée, inscrite ou non à un livre généalogique officiel (LOF et LOOF), même sans numéro SIRET.
La notion d’éleveur amateur a disparu par l’ordonnance du 7 octobre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016. L’expression « éleveur professionnel » est désormais un pléonasme.
L’adhésion à la MSA s’opère par le truchement de la chambre d’agriculture auprès de laquelle l’éleveur adresse son dossier de demande d’immatriculation via le guichet unique de formalités tenu par l’INPI. La chambre d’agriculture ou l’INPI transmet une copie dudit dossier à la MSA, notamment si un formulaire TNS (Travailleur Non-Salarié) y est joint.
Cependant, l’éleveur qui a produit une unique portée par année inscrite au LOF ou au LOOF est dispensé de s’immatriculer à la chambre d’agriculture en vertu des dispositions de l’article L. 214-6-2 du code rural.
Il en résulte la situation ubuesque qu’un éleveur d’une seule portée par an au LOF ou au LOOF soit assujetti à la MSA, en raison du revenu généré par la vente de son unique portée annuelle, s’il possède deux femelles reproductrices et/ou s’il consacre plus de 149 heures par an cette activité, mais sans être pour autant tenu de s’immatriculer à la chambre d’agriculture et donc de se voir attribuer un numéro SIREN.
C - Dispositif spécial pour les chômeurs ou allocataires des minimas sociaux
Il existe un dispositif d’exonération durant 12 mois pour les chômeurs ou les bénéficiaires de minimas sociaux qui créent ou reprennent une exploitation agricole.
D – Le statut social du collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole
La personne qui travaille régulièrement à l’exploitation de son conjoint, sans être rémunérée et sans avoir de statut, a l’obligation légale d’en choisir un. Cette obligation a pour but de protéger ce conjoint dévoué en lui conférant une protection sociale indispensable, et ce pour un coût modéré.
Sans statut, le conjoint qui collabore ne bénéficie pas de droits individuels en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle, d’invalidité, d’allocation de remplacement maternité, de retraite, et de formation.
Plus largement, le conjoint qui collabore sans avoir de statut n’est pas protégé face aux aléas de la vie professionnelle et personnelle.
Il est possible de choisir le statut de collaborateur même si l’on exerce une activité salariée en dehors de l’exploitation familiale ou de l’entreprise agricole.
La déclaration du conjoint comme collaborateur présente également l’intérêt pour le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole d’être en règle vis-à-vis du droit pénal.
L’emploi d’une personne dans une exploitation sans rémunération et sans statut de conjoint collaborateur, d’associé ou de salarié, peut consister en du travail dissimulé, délit correctionnel puni de 5 ans d’emprisonnement, sans préjudice d’une amende pouvant mettre en péril l’entreprise.
Pour obtenir le statut de conjoint collaborateur, il suffit de remplir le formulaire de demande, disponible sur le site internet de la MSA, puis de l’adresser par voie de recommandée avec demande d’avis de réception ou encore de l’y déposer contre reçu.
Si la personne remplit les conditions pour l’octroi du statut de conjoint collaborateur, son statut prend effet à la date de réception de la déclaration.
Pour obtenir le statut de conjoint collaborateur, la personne doit être soit mariée, soit pacsée, soit vivre en concubinage avec le chef d’exploitation ou avec le chef de l’entreprise agricole exerçant à titre individuel ou sociétaire.
Le statut de conjoint collaborateur ne procure pas à l’intéressé d’assurance chômage ou de rémunération. Il est donc fortement conseillé au conjoint concubin, partenaire pacsé sans présomption d’indivision ou marié sous un régime séparatiste, de convenir d’un contrat de travail, et donc d’obtenir le statut de salarié, si l’exploitation a pour cadre une entreprise individuelle, une EIRL, ou une EURL et que les rapports de travail peuvent justifier un lien de subordination.
Si l’exploitation a pour cadre une société, le statut de conjoint collaborateur n’est pas envisageable, sauf le cas de collège de gérance majoritaire dans les SARL. Mais, en dehors de cette hypothèse, le conjoint dévoué à l’entreprise devra être soit un associé avec une participation significative, soit un salarié.
Un élevage se développe avec le temps et prend de la valeur. Ne pas être rémunéré lorsque l’on est le propriétaire unique de l’élevage n’est pas grave en soi. En revanche, ne pas être propriétaire, tout en œuvrant pour l’élevage de son conjoint, sans recevoir rémunération ou part du capital, peut être source d’injustice en cas de séparation.
E – le statut d’aide familial
L’aide familial est celui qui vit et travaille au sein d’une exploitation, sans avoir le statut de salarié. L’état d’aide familial ne peut durer plus de 5 ans. Au-delà, l’intéressé doit obtenir un autre statut ou quitter l’exploitation. L’aide familial doit être âgé d’au moins 16 ans et être membre de la famille (ascendant, descendant, collatéraux) du chef d’exploitation ou de son conjoint, lesquels doivent vivre à l’exploitation et participer à sa mise en valeur, sans avoir le statut de salarié.
La MSA comptabilise les trimestres de retraite des aides familiaux à la caisse de base (AVA) et à la caisse complémentaire (RCO).